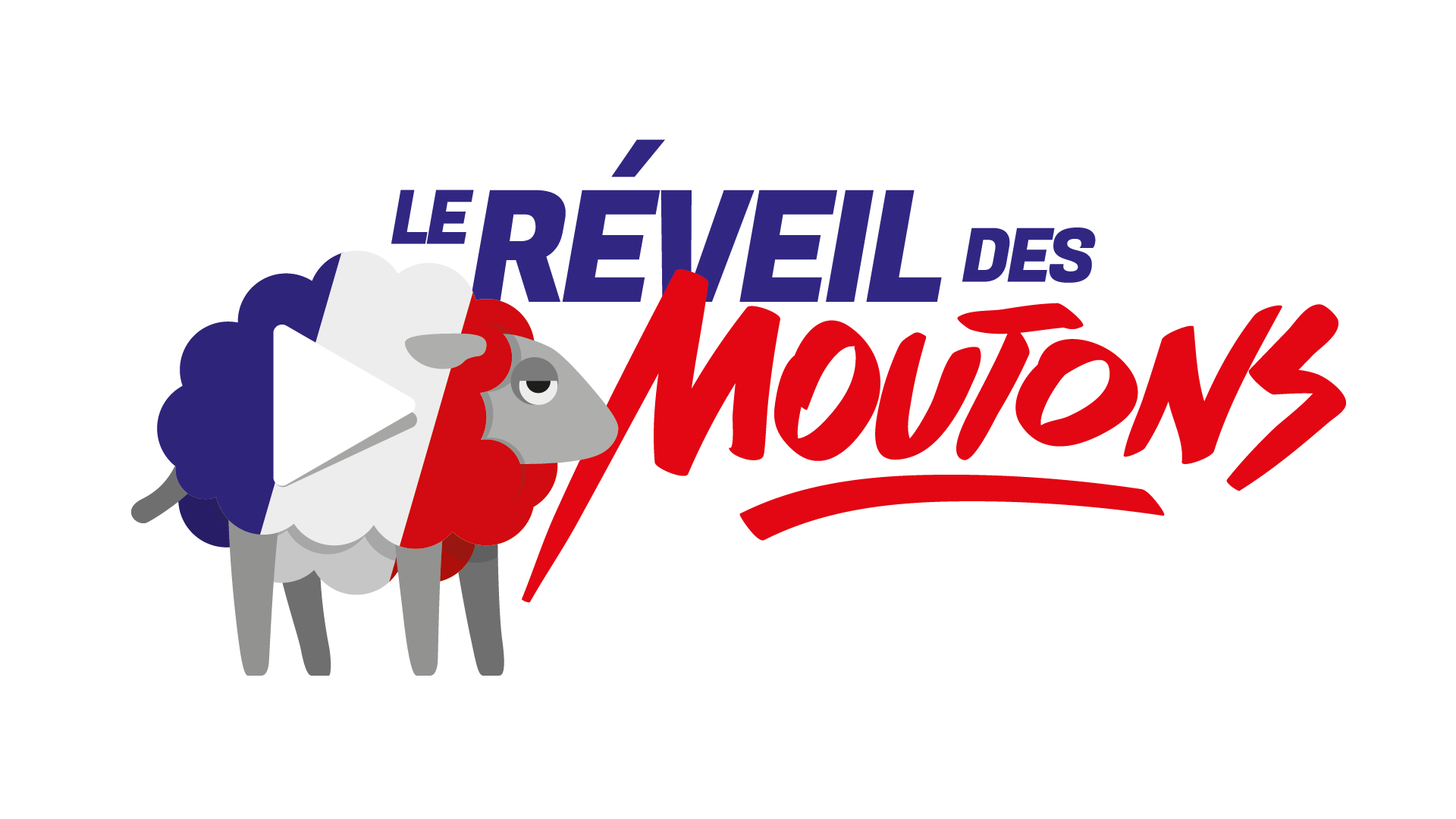L’Homme et la guerre… selon Ernst Jünger.
7 min read
24452 Views
Avant de vous citer quelques-uns des écrits les plus vibrants que Jünger ait pu nous offrir, laissez-moi quelques lignes, en guise d’introduction, afin de vous conter brièvement cet étonnant personnage.
Ernst Jünger est un écrivain allemand, né en 1895 et mort en 1998. A l’âge de 17 ans, il s’engage dans la légion étrangère, en France. A 19 ans, il participe activement à la Première Guerre mondiale (dans le camp allemand), au fond des fameuses tranchées et fut blessé quatorze fois au combat. 1918, la guerre se termine, E. Jünger reçoit la plus haute décoration allemande accordée à un jeune lieutenant, la croix « Pour le Mérite ».
Inutile d’ajouter que cet homme-là sait de quoi il parle lorsqu’il évoque la guerre. Dans les extraits ci-dessous, piochés ici et là, l’Homme et la guerre sont mis à nu par l’auteur. Pas de froufrous, pas de bla-bla comme dirait l’autre. Pas de tabou non plus. Juste une vérité pure… Froide, droite et cruellement sincère, ficelée par une plume incomparable.
Ici, il n’est nullement question de prendre parti pour ou contre la guerre. Le but n’est pas là. Il est juste de prendre un peu plus conscience de ce qu’est la guerre pour l’homme, selon Jünger.
La guerre raconte l’Homme autant de fois que l’Homme raconte la guerre. Ils sont ancrés l’un dans l’autre. Tous les deux sont indissociables depuis la nuit des temps.
« L’individu se construit, pareillement, des pierres innombrables. Il traîne derrière lui sur le sol la chaîne sans fin de ses aïeux ; il est ligoté et cousu par mille liens et fils invisibles aux racines entrelacées de la paludéenne et primordiale forêt dont la fermentation torride a couvé son germe premier. Certes la sauvagerie, la brutalité, la couleur crue propre à l’instinct se sont lissées, polies, estompées au fil des millénaires où la société brida la pulsion des appétits et des désirs. Certes, un raffinement croissant l’a décanté et ennobli, mais le bestial n’en dort pas moins toujours au fond de son être. Toujours, il est en lui beaucoup de la bête, sommeillante sur les tapis confortables et bien tissés d’une civilisation lisse, dégrossie, dont les rouages s’engrènent sans heurts, drapés dans l’habitude et les formes plaisantes ; mais sinusoïde de la vie fait-elle brusquement retour à la ligne rouge du primitif, alors les masques tombent : nu comme il l’a toujours été, le voilà qui surgit, l’homme premier, l’homme des cavernes, totalement effréné dans le déchaînement des instincts. L’atavisme surgit en lui, sempiternel retour de flamme dès lors que la vie se rappelle à ses fonctions primitives. Le sang, qui dans le cycle machinal des villes, ses nids de pierre, irriguait froid et régulier les veines, bouillonne écumant, et la roche primitive,, longtemps froide et raide couchées dans les profondeurs enfouies, fond à nouveau chauffé à blanc. Elle lui siffle à la face, jet de flamme dardée qui le dévore par surprise, s’il se risque à descendre au labyrinthe des puits. Déchiré par la faim, dans la mêlée haletante des sexes, dans le choc du combat à mort, il reste tel qu’il fut toujours. »
De la guerre, l’Homme souffre et meurt.
Ernst Jünger, dans le prochain extrait, nous crache son dégoût de la guerre en pleine figure avec un talent inégalé.
« La pourriture. Plus d’un se défaisait sans croix ni tertre à la pluie, au soleil et au vent. Les mouches bourdonnaient en nuage serré autour de sa solitude, un halo de lourde touffeur le cernait. On reconnaît entre toute l’odeur de l’homme en putréfaction, lourde, douceâtre, ignoblement tenace comme une bouillie qui colle. Après les grandes batailles, elle pesait en chape de plomb sur les terres, au point que les plus affamés en perdaient l’appétit.
Souvent, une escouade de lurons taillés dans le bronze se maintenait d’interminables jours dans les nuées de la bataille, agrippés à un bout de tranchée anonyme ou une ligne d’entonnoirs, comme les naufragés se cramponnent dans l’ouragan à des mâts brisés. La mort avait planté en terre au milieu d’eux son étendard de grand capitaine. Champs de cadavres devant eux, fauchés par leurs projectiles, à côté d’eux, entre eux les cadavres des camarades, la mort jusque dans leurs yeux, étrangement fixes au fond des visages qui rappelaient l’atroce réalisme des anciennes crucifixions. Presque à bout, ils s’entassaient dans une pourriture qui devenait insupportable lorsqu’un nouvel orage de fer faisait voler la raide danse macabre, projetant haut dans les airs les corps défaits.
Que servait de répandre sur les plus proches du sable et de la chaux, de jeter sur eux une toile de tente pour échapper au spectacle constant des visages noirs et enflés. Il y en avait trop ; partout, la bêche heurtait de la chaire ensevelie. Tous les mystères du tombeau s’étalaient dans une hideur à faire pâlir les rêves les plus fous. Les cheveux tombaient des crânes par touffes, comme le feuillage pâli des arbres à l’automne. Plus d’un se défaisait en verdâtre gelée de poisson qui luisait dans les nuits sous les lambeaux des uniformes. Quand on marchait sur eux, le pied laissait des traces phosphorescentes. D’autres se desséchaient en momies calcifiées qui se desquamaient lambeau par lambeau. Chez d’autres encore, les chairs coulaient des os en gélatine brun rougeâtre. Dans les nuits lourdes, des cadavres boursouflés s’éveillaient à une vie de fantôme lorsque les gaz comprimés s’échappaient des blessures à grands sifflets et gargouillis. Mais le plus terrifiant était le grouillement frénétique où se dissolvaient les corps qui ne se composaient plus que de vers innombrables.
A quoi bon ménager vos nerfs ? Ne sommes-nous pas restés une fois, quatre jours de suite, dans un chemin creux entre des cadavres ? N’étions-nous pas tous, morts et vivants, recouverts d’un épais tapis de grandes mouches bleu sombre ? Peut-on encore aller plus loin ? Oui : plus d’un gisait là avec qui nous avions partagé mainte veille nocturne, mainte bouteille de vin, maint quignon de pain. Qui peut parler de la guerre, qui n’a point été dans nos rangs ?
Lorsque après de telles journées le soldat du front traversait les villes de l’arrière, en colonnes grises et muettes, voûté, dépenaillé, sa vue parvenait à figer sur place l’insouciant train-train des écervelés de ces lieux. « On les a sortis des cercueils », chuchotaient-ils à l’oreille de leur bonne amie, et tous ceux qu’effleuraient le vide des yeux morts se mettaient à trembler. Ces hommes étaient saturés d’horreur, ils eussent été perdus sans l’ivresse. Qui peut mesurer cela ? »
Ce passage est saisissant d’horreur. C’est cela aussi la guerre, il faut le savoir. Jünger, par son génie littéraire nous permet de ressentir intensément ce qu’est l’enfer de la guerre.
Seulement, toujours selon Jünger, la guerre est bien plus que cela.
« Tel est le cercle d’émotions, la lutte qui fait rage dans la poitrine du combattant, lorsqu’il erre par le désert de flammes des gigantesques batailles : l’horreur, l’angoisse, l’anéantissement pressenti, la soif d’un déchaînement intégral dans la lutte. Une fois que ce petit monde en soi, bolide fonçant par le monstrueux, a déchargé son plein de sauvagerie bourrée jusqu’à la gueule en brusque explosion d’instants perdus à jamais pour la mémoire claire, une fois que le sang a coulé à flots de sa propre blessure ou de celle de l’autre, les brouillards tombent devant ses yeux. Il promène autour de lui des yeux fixes, somnambule éveillé de rêves oppressants. Le rêve monstrueux que l’animalité à rêvé de lui, au souvenir des temps où l’homme, parmi des hordes toujours menacées, frayait en guerrier son chemin dans le désert des steppes, se dissipe et le laisse à lui-même, effaré, ébloui par l’insoupçonné dans sa propre poitrine, épuisé par la gigantesque dissipation de vouloir et de force brutale.
C’est alors seulement qu’il prend conscience du lieu où l’a jeté la course de l’assaut, des périls en foule auxquels il vient d’échapper, et blêmit. Une fois cette limite franchie, et là seulement, commence la bravoure. »
De la guerre, l’Homme véritable nait.
Si c’est l’Homme qui fait la guerre… c’est la guerre qui fait l’Homme.
… Selon Ernst Jünger.
Force et honneur !
Article écrit par Augustin pour le Réveil des Moutons
Soutenir efficacement : Virement bancaire, Patreon, Paypal : manulrdm@gmal.com